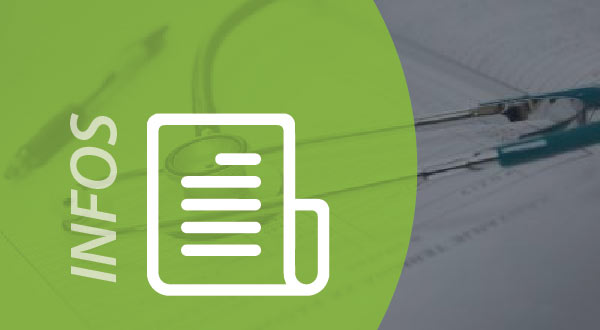Installation, liberté et avenir de la profession médicale
Par Florence Doury-Panchout
Les discussions autour de la proposition de loi dite « Garot », et notamment la régulation de l’installation des médecins, révèlent un moment charnière pour notre profession. Ce sujet touche à quelque chose de fondamental : la place du médecin dans le système de santé de demain.
L’amendement adopté, qui conditionne l’installation dans 13 % des zones dites « bien dotées » au départ d’un confrère, s’applique à tous les statuts, y compris les salariés. Mais on ne régule pas une pénurie. Rationner ce qui n’existe déjà plus ne résoudra rien. Cette mesure est symbolique, inefficace, et avant tout politique : elle acte une prise de contrôle sur l’organisation médicale, sans réel impact sur l’accès aux soins.
Elle s’inscrit surtout dans une dynamique plus large de transformation du système de santé, amorcée depuis plusieurs années, où les décisions s’enchaînent sans ligne directrice claire. Ce qui interpelle, ce n’est pas tant les réformes elles-mêmes (dont certaines sont utiles et attendues) que la manière dont elles sont conduites : en silos, sans vision d’ensemble, ni réflexion partagée sur l’organisation du soin.
Élargissement des compétences des professions non médicales, montée du salariat en soins primaires (centres de santé), réorganisation des soins primaires, injonctions à la productivité, régulation de l’installation… Autant d’évolutions mises en œuvre sans cohérence, sans concertation, et au risque de créer des tensions interprofessionnelles, d’affaiblir l’autonomie soignante, et de servir des logiques corporatistes, électoralistes ou financières plutôt que l’intérêt du soin. Dans ce contexte, le rôle médical se dilue, sa responsabilité s’émiette, son autorité clinique s’efface.
La finalité du système de santé n’est pas d’être rentable, mais d’améliorer la santé des patients, individuellement et collectivement. Cela suppose un engagement clair de l’État, y compris financier : vouloir à tout prix limiter les dépenses, au détriment de la santé elle-même, est une illusion dangereuse. Les médecins ont la responsabilité de défendre l’intérêt des patients et de s’opposer à une logique purement comptable et administrative, qui fragilise le soin et menace le sens même de leur métier.
Or, le métier médical a profondément évolué : coordonnateur, clinicien, pédagogue, interface territoriale, entrepreneur, manager, acteur de santé publique…et avant tout soignant. Ce socle de compétences ne peut rester invisible : il appelle une reconnaissance financière et statutaire, mais aussi la réaffirmation du rôle du médecin comme garant du sens clinique, de la qualité des parcours et de la cohérence du système. Ne pas redéfinir le rôle du médecin dans ce nouveau paysage, c’est organiser sa marginalisation voire sa substitution, au risque de décourager ceux qui font encore le choix de cet engagement.
« Être médecin aujourd’hui, c’est choisir un métier exigeant, long, souvent difficile, mais profondément humain. Ce n’est pas un privilège concédé par l’État. Ce n’est pas une dette à rembourser. » C’est le cri sincère d’un jeune confrère MPR qui rappelle que l’engagement médical repose d’abord sur le sens et l’éthique. Les études médicales sont longues, coûteuses (aussi en termes d’opportunités perdues), mal rémunérées pendant les années d’internat. Penser que l’État « finance » ces études pour exiger ensuite une installation dirigée, c’est méconnaître le quotidien des étudiants, leur charge mentale, et la réalité de leur investissement.
Alors que la médecine libérale représente encore aujourd’hui 75 % des consultations médicales et plus de 60 % des actes, l’installation libérale devient un parcours d’obstacles : prise de risque économique, faible protection sociale (notamment lors de la maternité), absence de soutien administratif, pressions croissantes sur l’activité. Comment attirer de jeunes médecins dans un modèle aussi exigeant, s’il n’est pas porté par une vraie reconnaissance ?
En face, le modèle salarié se développe en ambulatoire, souvent perçu comme plus stable, plus structuré. Il séduit. Mais sa généralisation, sans stratégie territoriale, risque de fragiliser l’équilibre déjà précaire de l’offre libérale, pourtant majoritaire dans l’accès aux soins. Le rapport IGAS 2023 rappelle que les centres de santé sont moins productifs, plus coûteux, parfois même non viables financièrement. Et dans certains cas, les dérives ne sont plus théoriques : 7 centres de santé ont été déconventionnés en avril 2025 pour fraudes massives.
Autre dérive : la financiarisation. Des fonds d’investissement investissent déjà la santé, dictant des logiques de rentabilité. Quand le soin devient prestation, que le médecin applique des protocoles standardisés, qu’il ne décide plus, alors ce n’est plus une profession, c’est une fonction.
Il est temps de réagir ensemble ! Le sujet de la régulation de l’installation n’est qu’un symptôme. C’est l’ensemble du modèle de santé qui évolue sans vision partagée, sans projet global, sans les médecins.
Ce n’est pas une querelle de statuts : libéraux et salariés sont pris dans la même dynamique de perte d’autonomie, avec les mêmes symptômes : surcharge administrative, multiplication des indicateurs (souvent absurdes), bureaucratie, contrôles et contraintes multiples… Ce n’est pas une querelle de professions de santé : nous faisons tous face aux mêmes injonctions, dans un système en mutation, souvent sans concertation. Ce n’est pas une querelle de pouvoir : c’est une exigence de clarté, de reconnaissance, de coordination. En MPR, la collaboration interprofessionnelle est notre quotidien. Elle fonctionne quand les rôles et les responsabilités sont définis, assumés et articulés.
Ne nous opposons pas. Unissons nos forces, médecins libéraux et salariés, avec les autres professions de santé, pour défendre un système fondé sur la qualité des soins, la coordination, la responsabilité clinique, la liberté d’exercice.
Le SYFMER appelle à :
• Renforcer l’attractivité des spécialités cliniques comme la MPR, particulièrement dans leur exercice libéral
• Clarifier les périmètres professionnels, dans un cadre national, concerté et interprofessionnel,
• Reconnaître et accompagner la transformation du métier médical, y compris ses dimensions non cliniques,
• Préserver le pluralisme des modes d’exercice,
• Lutter activement contre la financiarisation de la santé, en redonnant du pouvoir aux soignants, et non aux gestionnaires de fonds publics ou privés.
Nous devons revendiquer le droit de participer à la refondation du système de santé, d’y apporter notre expertise, notre vision du terrain, nos exigences éthiques. Ne laissons pas le pouvoir médical s’éteindre, au profit de modèles sans projet, sans cohérence, et de plus en plus souvent… sans médecins.
L’autonomie de la médecine est en jeu. Le SYFMER sera au rendez-vous.